|
Niveau d’études :
Bac+5
|
Bac conseillé :
Scientifique
|
Employabilité :
Excellente
|
|
Mobilité :
Excellente
|
Salaire débutant :
4 166 € brut mensuel
|
Salaire expérimenté :
12 500 € brut mensuel
|
|
Code ROME :
M1802
|
Code FAP :
M2Z
|
Le métier en résumé
Le métier de threat hunter nécessite une formation de niveau Bac+5 en informatique, complétée par des certifications spécialisées et une expérience significative en cybersécurité. Côté rémunération, elle est particulièrement attractive avec un salaire mensuel brut débutant à 4 166 € et pouvant atteindre 12 500 € pour les experts confirmés. L’employabilité est excellente, tout comme la mobilité. Les perspectives d’évolution incluent des positions d’analyste en réponse aux incidents ou de chasseur de primes en cybersécurité. Ce métier correspond aux codes ROME M1802 et FAP M2Z, références importantes pour les recherches d’emploi.
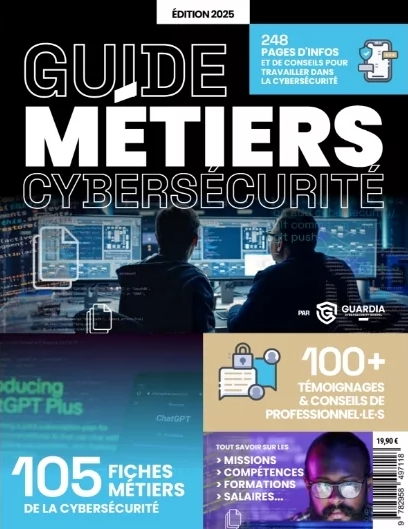
Guide des métiers de la Cybersécurité
Threat hunter : comprendre le métier
Ce métier consiste à rechercher des cybermenaces dissimulées dans les systèmes, et ce, avant qu’elles ne déclenchent d’alertes ou ne causent des dommages. Il cible particulièrement le « top 10 » des cybermenaces avancées, ces attaques sophistiquées qui représentent environ 20 % des menaces, mais échappent aux solutions standards.
Pour ses investigations, le threat hunter s’appuie sur une méthode très scientifique qui commence par la formulation des hypothèses basées sur sa connaissance des techniques d’attaque. Puis, le test avec des outils d’analyse avancés pour identifier les schémas anormaux qui signalent la présence d’adversaires.
Les missions du threat hunter
La mission principale du threat hunter est de rechercher les menaces dissimulées avant qu’elles ne se manifestent. Détecter les signaux faibles et comportements anormaux qui échappent aux systèmes automatisés.
Il collecte également un maximum d’informations sur les comportements et méthodes des adversaires potentiels, comprenant leurs tactiques, techniques et procédures (TTP).
Il organise et analyse les données recueillies pour identifier des tendances significatives, qui établissent des corrélations entre différents des événements apparemment sans lien.
Enfin, il établit des prévisions pour anticiper les futures attaques et élimine les vulnérabilités existantes avant qu’elles ne soient exploitées.
Les responsabilités du threat hunter
Ce professionnel assume trois grandes responsabilités. La première est l’anticipation et l’innovation pour rester en avance sur les menaces émergentes. La deuxième concerne l’investigation et l’identification des menaces invisibles aux outils automatisés accompagné de la vulgarisation des découvertes. Quant à la dernière, il s’agit de l’identification précoce des menaces sophistiquées.
Le métier Threat hunter vous intéresse et vous souhaitez postuler ? Vous pourrez trouver des offres correspondant à votre recherche sur les sites d’emploi comme Indeed, Apec, le réseau social LinkedIn ou sur la plateforme RegionJob.
Les compétences demandées par le poste
Le threat hunter doit maîtriser les environnements informatiques, tant Windows que Linux/Unix, pour savoir distinguer comportements normaux anormaux. Il doit aussi connaître les vecteurs d’attaque des logiciels malveillants et les tactiques des acteurs de la menace.
De plus, des compétences en criminalistique numérique et analyse de données sont indispensables. Il faut aussi une maîtrise de la sécurité des réseaux et des terminaux, et ce, avec une expertise des différents protocoles comme la pile TCP/IP.
Enfin, il est important de se doter de compétences en ingénierie inverse et en codage pour analyser les logiciels suspects et d’automatiser certaines tâches d’investigation.
Les qualités personnelles
Pour être efficace dans ce rôle, il faut développer une forte capacité d’analyse et de raisonnement déductif pour formuler et tester des hypothèses sur les intrusions potentielles.
La résistance au stress est aussi indispensable, car les enjeux sont parfois considérables et la pression intense.
En outre, une aptitude innée en matière de documentation et de communication est nécessaire pour transformer les observations techniques en informations exploitables pour différents interlocuteurs. La curiosité intellectuelle complète le profil, car il faut toujours apprendre pour être en avance.
Qualités
- Capacité d’analyse
- Raisonnement déductif
- Résistance au stress
- Compétences en documentation
- Compétences en communication
- Curiosité intellectuelle
Parcours et formations
Pour accéder à ce métier, d’abord, obtenir un diplôme de niveau Bac+5 en informatique, idéalement spécialisé en cybersécurité. Ensuite, décrocher des certifications professionnelles spécifiques comme OSCP, SANS GIAC (GCFA ou GNFA) ou CTI-P qui renforcent significativement le profil.
Ce n’est pas un métier pour débutants. Donc, une expérience préalable est indispensable (en tant qu’analyste SOC, spécialiste en réponse aux incidents ou expert en analyse forensique).
Quid du salaire ?
Le salaire de début est d’environ 4 166 € bruts par mois. Puis, cela évolue progressivement au fur et à mesure que l’on développe ses compétences, pour devenir threat hunter confirmé, payé à 12 500 € mensuel ou plus.
Évolution de carrière
Ce métier offre plusieurs évolutions possibles : analyste en réponse aux incidents, « chasseur de primes » (bug bounty hunter) en cybersécurité, ou intégration de grandes entreprises spécialisées et de MSP d’envergure. Pour les profils les plus expérimentés, des positions de direction d’équipes de threat hunting ou de conseil stratégique en sécurité proactive sont possibles.
Les employeurs potentiels
Plusieurs types d’organisations recrutent ce profil. On peut citer entre autres les grandes entreprises dans les secteurs sensibles comme la banque, l’assurance, la défense, l’énergie ou la santé, qui intègrent des threat hunters à leurs équipes internes.
En France, les Managed Service Providers (MSP) spécialisés en cybersécurité représentent un important volume de recrutement. Les éditeurs de solutions de cybersécurité emploient également ces experts pour améliorer leurs produits et services, notamment FireEye/Mandiant, CrowdStrike, IBM Security, Microsoft Security, Orange Cyberdefense ou Thales.
Les avantages et les inconvénients du métier
Dans ce métier, l’avantage est surtout la stimulation intellectuelle. De plus, l’impact du travail est significatif et concret : détecter une menace avancée peut sauver une organisation d’une crise importante. Par ailleurs, la rémunération est particulièrement attractive, parmi les plus élevées du secteur.
Cependant, la pression peut être considérable face à des adversaires hautement qualifiés, et l’échec à détecter une intrusion peut avoir des conséquences dramatiques sur sa carrière. Le métier peut paraître intellectuellement fatigant avec de longues périodes d’investigation minutieuse sans garantie de résultat immédiat.
Devenir threat hunter
L’accès à ce profil est conditionné par l’obtention d’un diplôme de niveau Bac+5 en informatique et cybersécurité, lequel est complété par des certifications spécialisées.
Mais avant de se spécialiser, faut-il encore une expérience significative dans d’autres rôles de cybersécurité. La maturité professionnelle requise peut être obtenue en s’habituant à la chasse aux menaces : participer à des formations avancées et pratiquer les techniques apprises dans le cadre professionnel.
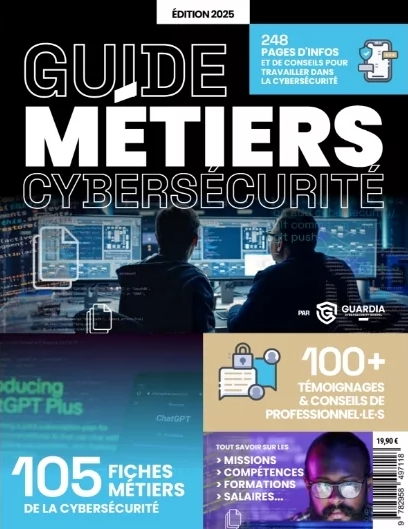
Guide des métiers de la Cybersécurité
Quelle est la différence entre un threat hunter et un analyste SOC ?
L’analyste SOC travaille principalement en mode réactif et répond aux alertes générées par les systèmes de détection. Le threat hunter, lui, adopte une approche proactive, qui consiste à rechercher activement les menaces qui ne déclenchent pas d’alertes automatiques.
Faut-il avoir été hacké pour être un bon threat hunter ?
Une bonne connaissance des techniques offensives est précieuse, mais peut s’acquérir légalement à travers des formations et des environnements d’entraînement dédiés. L’essentiel est de comprendre comment pensent les attaquants pour anticiper leurs actions et détecter leurs traces.
Quels sont les principaux outils utilisés par un threat hunter ?
L’arsenal typique inclut des systèmes SIEM pour l’analyse des logs, des plateformes de threat intelligence, des outils d’analyse de mémoire et de trafic réseau, ainsi que des solutions d’EDR, complétés par des scripts personnalisés.
Comment mesurer l'efficacité d'un threat hunter ?
Les indicateurs pertinents incluent le nombre de menaces avancées détectées non signalées par les outils automatisés, la réduction du « dwell time » (temps de présence non détectée d’un attaquant), et la qualité des recommandations dans l’amélioration de la posture de sécurité.

